Les lecteurs.trices sont averti.e.s avant même d’entrer dans ce roman par une citation du philosophe Michel Foucault dûment choisie et sa réponse en page 214.
« Sans doute l’objectif principal aujourd’hui n’est-il pas de découvrir, mais de refuser ce que nous sommes » (M. Foucault, en p. [9])
« Nous n’avons pas de regret sur la façon dont nous avons mené l’ordre public et la sécurité publique. Et ce n’est pas parce qu’une main a été arrachée, parce qu’un œil a été éborgné, que la violence est illégale » (L. Munez, secrétaire d’État à l’Intérieur, p. [214]).
Il va falloir interroger la vérité de notre identité masquée. Il va falloir rendre compte d’un déni de dérive qui se déroule sous nos yeux depuis, a minima, les manifestations contre la loi travail de 2016 et qui rappelle les sombres heures de la bastonnade mortelle, tuant Malik Oussekine en 1986.
Sous la forme d’une succession de flashs, de citations et de signalements, David Dufresne nous livre un thriller psychologique qui scrute nos fonctionnements collectif et étatique face au mouvement des Gilets Jaunes. Le texte est à la fois vif dans ses descriptions, mesuré dans son analyse, profond dans son interrogation. Jusqu’où peut-on aller dans le maintien de l’ordre dans un régime démocratique, quelles lectures font les médias d’une situation insurrectionnelle et exceptionnelle, qui détient l’ordre du discours (« violences policières caractérisées vs maintien de l’ordre absolu »), où se trouvent les vérités et à partir de quoi sont-elles érigées ? De quelle côté s’organise la violence ? Qui est légitime et qui ne l’est pas ? Où est la preuve ? Qui la fabrique ? Qui la cache et la démonte ? Que se passe-t-il en coulisses ? Telles sont les questions que sous-tendent ce texte-témoignage.
Le roman retrace quelques mois d’une aventure aussi tragique que singulière, celle d’une rébellion jaune fluo, populaire, maladroite, à la fois bonne enfant et violente, mutilée et résiliente, téméraire et terrorisée, déterminée et fatiguée, non définitive et historique.
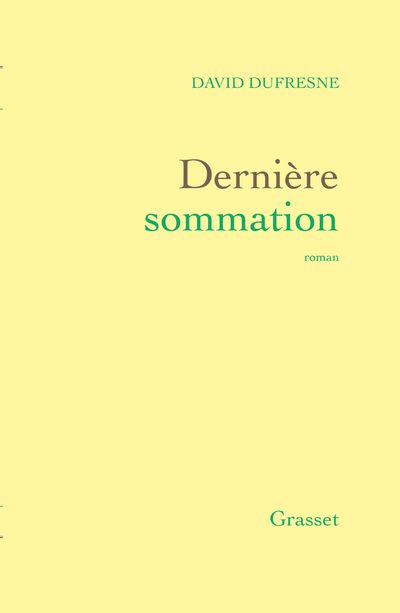
Par la voix de Dardel, son alter-ego, l’auteur justifie son action de signalement des violences policières et invoque une éthique « au delà-même du politique », clé centrale de son roman à thèse :
Oui, une affaire de morale, d’imagination. C’est la question du donneur d’ordre : l’État. L’État qui, en la matière, a toujours été celui qui déterminait le niveau de violence, et qui nous offre désormais son visage le plus brutal… Quand Max Weber nous parle du monopole de la violence légitime de l’État, on doit interroger chaque mot. Violence. Légitimité. Monopole. État. Quand l’État n’est pas à la hauteur de ses droits, quand il bafoue ces devoirs, qu’il y a faillite dans ses résultats, dans se façon de faire, dans ses tâches mal exécutées, il devrait y avoir débat, a minima. Mes signalements c’est ça. Des pièces au débat. Des contestations face à l’ État autoritaire. Je ne suis pas contre la police. Je me bats contre l’État policier (p. 203).
Par la voix de Vicky, la jeune femme mutilée devant l’Assemblée nationale, elle-même s’appuyant sur une citation d’Hélder Câmara, le célèbre évêque brésilien, il rappelle l’origine de la violence :
Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés.
La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres.
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. (p. 224-225).
Il fallait écrire ce texte, fouillis et désordonné comme une manifestation, déroutant dans son déroulement, particulier dans sa démonstration, pour ne pas oublier les réalités du présent et les défis de notre avenir proche. Il fallait conter cette expérience vécue de l’agressivité étatique et de la résistance à cette dernière. Sans parti pris intégral, à travers son roman, David Dufresne affiche sa défense d’un certain idéal, celui d’un État de droit bienveillant, celui de l’équilibre social, celui des solidarités perdues, celui de la vie de quartier et du rond point, celui des partages amicaux, celui de l’absurdité du déni. En ce sens, il faudra le relire dans quelques années, pour se souvenir, pour ne jamais oublier cette main arrachée, cet œil crevé, cette mâchoire brisée, cette joue déchiquetée, ce déluge de gaz, ce brasier social qui a fait vaciller un pouvoir gentrifié devenu délirant. Je laisse le dernier mot à l’auteur, témoin engagé d’une dérive fascisante exprimée jusque dans sa conclusion romanesque, qui nous interpelle en p. 222 : « Est-ce ainsi que naît l’Histoire ? »…
FX
Illustration : Lundi Matin © DR